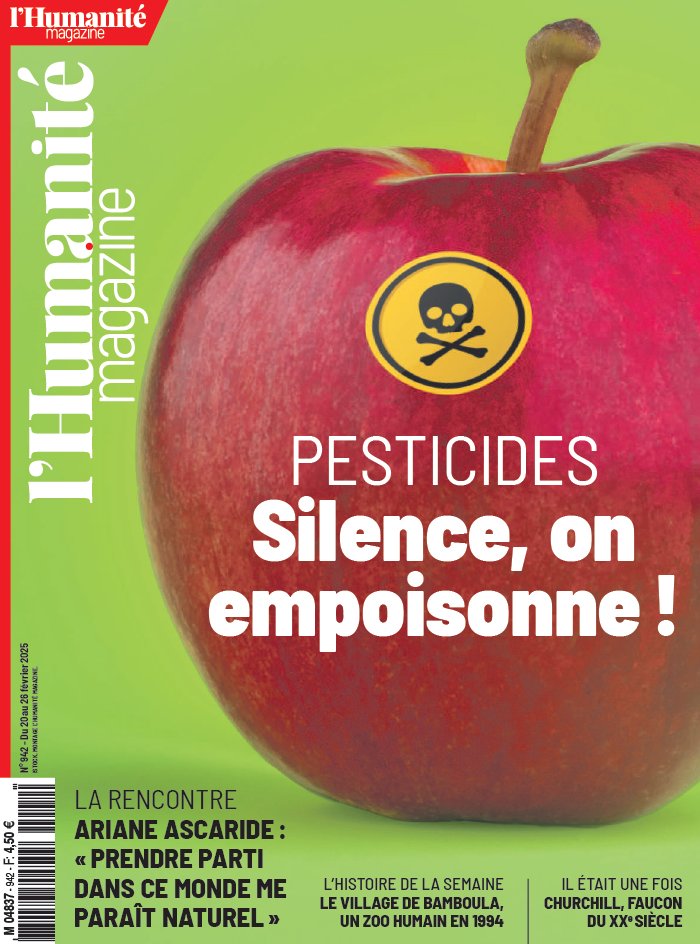Loin d’être des exceptions, les « zones écnomiques spéciales » façonnent aujourd'hui l’ordre mondial. L’historien canadien Quinn Slobo :dian analyse le fonctionnement de ces oparadis fiscaux et la place de premier plan qu’ils occupent à la faveur des victoires idéologiques des libertariens radicaux.
Depuis trente ans, le capitalisme s’organise au-delà des frontières nationales à travers plus de 5 400 « zones économiques spéciales », redéfinissant les logiques du pouvoir. Dans son dernier ouvrage, Le Capitalisme de l’apocalypse ou le rêve d’un monde sans démocratie, Quinn Slobodian explore cette transformation et met en lumière un projet plus radical : celui des libertariens radicaux, qui voient ces zones comme des alternatives aux États-nations démocratiques. Dans cet entretien, il revient sur les implications politiques mondiales de cette recomposition.
Comment ce que l’on appelait jusqu’ici les « paradis fiscaux » ont pu façonner et structurer ainsi le capitalisme contemporain ?
Pour comprendre, il faut déconstruire le récit dominant qui postule l’existence de deux trajectoires opposées pour l’économie mondiale : d’un côté, la poursuite de la mondialisation ; de l’autre, un repli nationaliste. Si l’on observe attentivement certaines dynamiques territoriales, une alternative se joue à l’intérieur même des nations, mais également au sein de petites enclaves qui s’affranchissent du cadre étatique traditionnel. Des chefs de gouvernements comme Victor Orban, Giorgia Meloni ou Boris Johnson ne cherchent pas tant à refermer leur pays sur lui-même qu’à renforcer sa compétitivité à l’échelle mondiale.
Cette stratégie passe notamment par la création de zones économiques spéciales, à l’instar de la Hongrie, qui y voit un levier d’attractivité pour les investissements étrangers. Beaucoup de figures issues du monde de la tech partagent cette vision qui tend à fragmenter les États en unités plus réduites, perçues comme plus fonctionnelles, tout en recherchant des alliances stratégiques à l’échelle mondiale auprès de micro-enclaves autonomes. Loin d’un rejet du capitalisme mondialisé, cette stratégie traduit plutôt une réinvention de celui-ci par les droites radicales, qui adaptent leurs territoires aux exigences du marché global.
Comment différencier néolibéraux et libertariens ?
Le néolibéralisme et le libertarianisme peuvent être considérés comme des concepts largement équivalents, ou du moins étroitement liés. Toutefois, cette dernière doctrine recouvre plusieurs courants de pensée distincts. L’un d’eux, l’anarcho-capitalisme, prônant l’abolition totale des structures gouvernementales, en constitue la forme la plus radicale. Longtemps relégué aux marges du débat intellectuel et politique, il était perçu comme une idéologie sans réelle influence. Sa montée en puissance est aujourd’hui manifeste, jusqu’à devenir une idéologie quasi dominante. Des chefs d’État comme Javier Milei s’en revendiquent explicitement.
Moins de vingt ans après la « fin de l’histoire », le fondateur de PayPal Peter Thiel affirmait ne plus croire en la compatibilité entre démocratie et liberté. Comment interpréter ce renversement de perspective ?
Les années 1990 sont généralement considérées comme l’ère du capitalisme démocratique. Mais ces réussites économiques les plus célébrées reposaient sur un capitalisme non démocratique, comme à Dubaï et à Hong Kong. L’invasion de l’Irak en 2003, officiellement menée au nom de l’implantation de la démocratie et du capitalisme, constitua également un désaveu et un tournant majeur, ébranlant le consensus. Un regard plus cynique s’est alors imposé, érigeant en modèles Dubaï ou la Silicon Valley, où le capitalisme pouvait prospérer sans être contraint par les exigences démocratiques.
Dès 2009, Curtis Yarvin, figure de la droite techno-libertarienne, oppose l’Irak démocratique mais chaotique à Dubaï, monarchie entrepreneuriale stable mais sans élections. Cette réflexion marque un tournant dans l’essor du néoréactionnarisme, qui remet en cause la démocratie libérale. Ce qui nous ramène à la relation entre néolibéralisme et libertarianisme. Ces courants ont toujours été traversés par une tension fondamentale : tout en dénonçant l’État et en affirmant leur rejet de son intervention, ils en dépendent pourtant pour la mise en œuvre de leurs propres politiques.
Après la victoire de Trump, comment cette fragmentation peut-elle se manifester aux États-Unis et dans le monde ?
Des figures telles que Musk, Altman ou Andreessen mobilisent autant que possible les ressources de l’État afin de financer des technologies de rupture dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, l’exploration spatiale ou les véhicules autonomes. C’est une forme de captation de l’État pour les intérêts de la Silicon Valley, ce complexe technico-industriel auquel Biden faisait référence dans son discours d’adieu, mettant en garde contre son emprise croissante. Si la captation de l’État vise son propre dépassement, elle peut conduire à une forme de sécession interne. Le démantèlement de l’État central favoriserait une décentralisation du pouvoir et des structures d’organisation, aboutissant à une fragmentation institutionnelle inédite.
Sur le même thème
Contrairement au complexe militaro-industriel, qui reposait sur une autorité centrale forte, cette dynamique tend à morceler les structures étatiques. Chaque État adapterait alors ses lois sur le travail, l’avortement, et sa fiscalité pour attirer des investisseurs et des résidents ciblés, une compétition dont les élites de la tech seraient les principales bénéficiaires. Cette dynamique s’inscrit dans un double mouvement : d’un côté, une expansion vers l’extérieur, où Musk investit des marchés en Italie ou en Chine ; de l’autre, un repli vers des espaces autonomes plus restreints, à l’image de la ville-entreprise qu’il développe au Texas.
Ce phénomène ne se limite ni à une dynamique strictement nationale ni à une expansion purement globale, mais repose sur un maillage territorial combinant des zones internes et externes. Loin de l’image traditionnelle de l’extrême droite, il en constitue pourtant une expression contemporaine. Le lien entre Musk et l’AFD ne peut être compris si l’on réduit l’extrême droite à un nationalisme territorial. Il s’agit plutôt d’un projet fondé sur l’interconnexion des marchés et une logique de compétitivité économique privilégiant l’optimisation plutôt que le protectionnisme.
L’Union européenne a-t-elle réellement les moyens de réagir alors qu’elle compte elle-même des « zones » en son sein ?
L’UE risque d’être contrainte d’ouvrir davantage ses marchés, d’assouplir sa réglementation. Elle semble dépourvue de moyens de pression face à ces exigences. Une annexion du Groenland par Trump est très probable en l’absence d’une opposition structurée au sein de l’Otan ou de l’UE. Le modèle américain d’exercice du pouvoir – ou, plus largement, le modèle impérial des États-Unis depuis 1945 – repose sur deux piliers : la domination par le marché mondial, via la puissance économique, et la gouvernance par les institutions internationales.
Sur le même thème
Si les États-Unis venaient à privilégier désormais l’exercice direct de leur puissance au détriment de ces mécanismes, cela serait d’autant plus difficile à contrer que la légitimité des institutions internationales, y compris celle de l’ONU, repose en grande partie sur l’adhésion et l’aval des États-Unis.
Le canal de Panama en constitue un exemple emblématique. Pendant des décennies, il fut littéralement désigné sous le nom de « la zone », incarnant un point névralgique du commerce maritime mondial. Si les États-Unis venaient à en reprendre le contrôle, ils s’empareraient d’un point stratégique au sein des infrastructures logistiques mondiale et consolideraient un réseau d’enclaves stratégiques. L’intérêt pour le Groenland, par exemple, ne réside pas dans la possession de l’île elle-même, mais dans l’implantation de bases militaires et l’exploitation de ses ressources minières qui deviendraient des « zones ».
Comment la gauche politique peut-elle réagir face à cette nouvelle donne ?
Les progressistes aux États-Unis imaginent qu’une victoire à la Maison-Blanche suffit à enclencher le changement, sans prendre en compte les délais nécessaires aux transformations structurelles. Le projet de Biden, ambitieux, exigeait du temps : construire des usines, embaucher des travailleurs et permettre une amélioration tangible du quotidien s’étend sur plusieurs années. À l’inverse, la Silicon Valley et le monde des cryptomonnaies fonctionnent sur des cycles beaucoup plus courts, où l’idée d’un enrichissement immédiat domine, donnant l’illusion qu’une vie peut basculer en un instant, d’un simple clic. Les profondes mutations structurelles ne peuvent rivaliser avec la rhétorique de Trump.
La recréation d’espaces collectifs au sein du monde du travail pourrait constituer un levier essentiel pour refonder une conception politique basée sur la solidarité et l’organisation collective. Aux États-Unis, la syndicalisation connaît un essor notable, comme en témoignent les mobilisations au sein d’entreprises telles que Starbucks, Whole Foods ou Amazon. Ce que l’on désigne en anglais sous le terme de « préfigurative communities » – ces communautés qui, dès à présent, incarnent le modèle de société qu’elles aspirent à faire advenir – demeure un levier essentiel. Mais leur émergence suppose une structuration et une organisation rigoureuses.
La fragmentation du capitalisme déplace-t-elle le cœur de la lutte au sein même des entreprises ?
La conscience de classe est quasiment absente aux États-Unis, du fait de la fragmentation du monde du travail. D’un côté, 12 millions de travailleurs sans papiers, précarisés, relégués au statut d’« outsiders » de la nation ; de l’autre, 12 millions d’influenceurs dont l’existence économique repose sur la marchandisation de leur image et de leur identité. Ces deux exemples illustrent une vraie dichotomie. Pour qu’une lutte des classes structurée émerge, il faut s’appuyer sur les espaces où des dynamiques de syndicalisation sont déjà à l’œuvre. Rappelons aussi que les magnats de la tech de la Silicon Valley détiennent les espaces mêmes où s’organise la communication : les plateformes sur lesquelles toute tentative de structuration collective pourrait émerger.
Créer un syndicat conduit naturellement à ouvrir un compte sur X, ce qui ne manque pas d’ironie. On s’organise dans un espace appartenant précisément à celui contre qui l’on entend lutter, qui dispose du pouvoir de censurer les messages qui lui déplaisent et de façonner une vision du monde qui neutralise toute possibilité d’unité. Des figures comme Mark Zuckerberg ont bâti leur fortune en mettant à disposition des espaces numériques où les utilisateurs produisent gratuitement du contenu, contribuant ainsi à l’enrichissement de ces plateformes. Renverser cette dynamique suppose une refonte en profondeur de la question de la propriété des données, et l’émergence d’alternatives aux outils dominants. À défaut, on ne fait que travailler gratuitement au service de ceux que l’on combat, en alimentant leur écosystème, à l’image de tous ceux qui publient sans contrepartie sur Twitter.
En savoir plus sur Quinn Slobodian :
Professeur d’histoire globale à l’université de Boston, il est un spécialiste de l’histoire du néolibéralisme. Le Capitalisme de l’Apocalypse est la traduction française d’un ouvrage paru outre-Atlantique en 2023. Il est également l’auteur de Les Globalistes. Une histoire intellectuelle du néolibéralisme paru en 2022 au Seuil.
Le Capitalisme de l’apocalypse ou le rêve d’un monde sans démocratie, de Quinn Slobodian, Seuil, 384 pages, 25,50 euros
Le journal des intelligences libres
« C’est par des informations étendues et exactes que nous voudrions donner à toutes les intelligences libres le moyen de comprendre et de juger elles-mêmes les événements du monde. »
Tel était « Notre but », comme l’écrivait Jean Jaurès dans le premier éditorial de l’Humanité.
120 ans plus tard, il n’a pas changé.
Grâce à vous.italisme est réinventé par les droites radicales »
à lire aussi

Du néolibéralisme au national-capitalisme
En débat
Publié le 19 février 2025

L’Homme est un loup-garou pour l’homme
En débat
Publié le 18 février 2025

« La police antiterroriste arrête un antifasciste pour le remettre à un état autoritaire » : l’écrivain Éric Vuillard apporte son soutien à Gino, menacé d’extradition vers la Hongrie
En débat
Publié le 11 février 2025